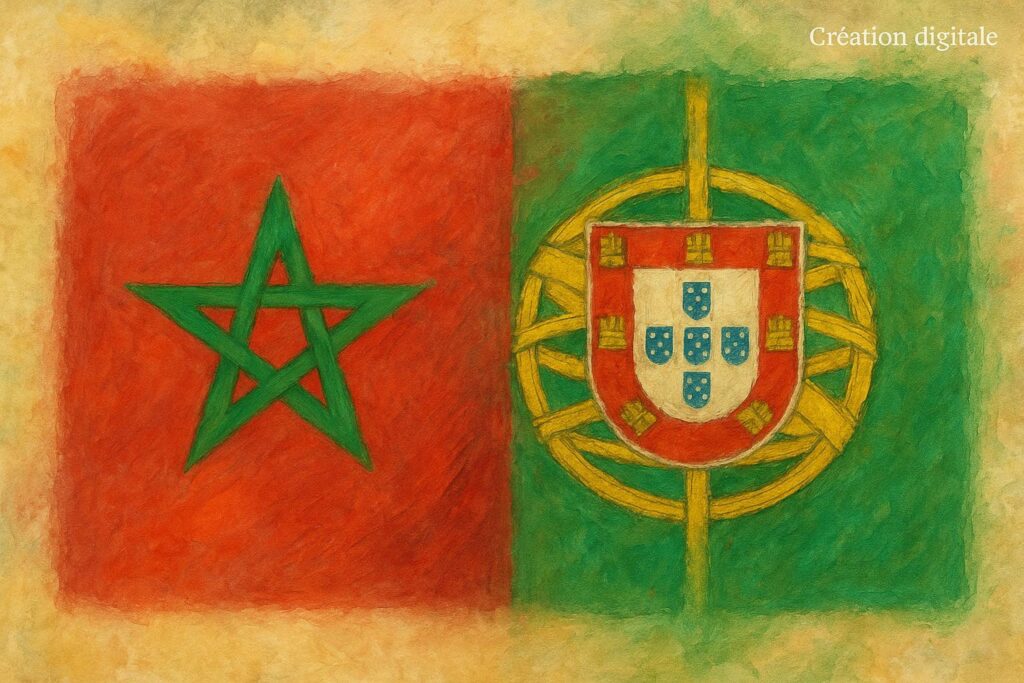Diplomatie atlantique et impératifs climatiques
Le déplacement à Lisbonne du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, sanctionné par une déclaration conjointe avec son homologue portugais Paulo Rangel, dépasse la geste protocolaire. Il consacre l’entrée d’un binôme sud-nord dans la diplomatie climatique, alors que la planète traverse un cycle de dérèglements sans précédent. En se réclamant d’un « multilatéralisme solidaire », les deux capitales s’alignent sur les attentes de la COP 28 : des partenariats transcontinentaux capables d’agréger financements européens, ressources renouvelables africaines et ingénierie industrielle ibérique.
Hydrogène vert : socle d’une géo-économie partagée
Au cœur du mémorandum figure la volonté d’accélérer le corridor de l’hydrogène vert, segment du vaste projet européen RePowerEU. Rabat ambitionne de convertir son potentiel solaire et éolien du Sahara atlantique en molécules d’ammoniac à faible teneur carbone, exportables vers les ports lusitaniens de Sines et de Setúbal. Lisbonne, pour sa part, y voit l’opportunité de repositionner son hinterland comme hub énergétique en substitution partielle du gaz russe. La création d’infrastructures de liquéfaction, le renforcement des câbles haute tension et la standardisation des certificats de durabilité seront discutés lors de la prochaine Réunion de Haut Niveau, que les deux chancelleries souhaitent tenir « dans les meilleurs délais ».
Interconnexions électriques : un maillage euro-africain
La déclaration souligne l’intérêt porté aux interconnexions électriques et maritimes. Depuis 2018, les gestionnaires de réseaux Plan Maroc Vert et Redes Energéticas Nacionais étudient un câble de 1 400 MW passant par l’axe Tanger-Algarve. À terme, cette dorsale permettrait, selon l’Institut portugais de l’énergie, d’intégrer 20 % d’électricité d’origine solaire marocaine dans le mix portugais d’ici 2030. Elle conforterait aussi l’objectif africain de l’Initiative pour les marchés de l’électricité de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale, qui promeut des échanges transfrontaliers afin de sécuriser les réseaux nationaux et d’abaisser le coût moyen du kilowattheure.
Coupe du Monde 2030 : vitrine d’une diplomatie verte
La co-organisation du Mondial 2030 par l’Espagne, le Portugal et le Maroc s’impose comme catalyseur de cette coopération. Les trois pays entendent présenter à la FIFA un dossier à faible empreinte carbone, articulé autour de stades passifs, d’une mobilité ferroviaire électrifiée et d’une compensation intégrale des émissions résiduelles. Interrogé à Rabat, un conseiller du comité de candidature assure que « le football sert ici de laboratoire au pacte vert euro-africain ». L’événement offre également un levier de diplomatie publique, capable de populariser auprès des opinions un narratif de prospérité partagée, loin des récits anxiogènes sur les migrations.
Portée africaine : répercussions et opportunités
Le rôle régional du Maroc, salué par Lisbonne pour sa contribution à la stabilité sahélienne, renforce l’idée d’un arc atlantique transversal allant de Tanger à Luanda. Dans cette perspective, l’Initiative du Roi Mohammed VI pour l’Atlantique, lancée en 2022, plaide pour l’inclusion logistique de l’Afrique de l’Ouest et centrale. Brazzaville, qui développe le gigantesque barrage de Sounda et explore la filière hydrogène à Pointe-Noire, pourrait tirer parti d’un réseau d’exportation mutualisé. À condition, toutefois, de conclure des protocoles de compatibilité réglementaire avec l’Union européenne sur la taxonomie verte.
Sur le plan sécuritaire, la convergence maroco-portugaise apporte une plate-forme de dialogue sur la surveillance maritime et la lutte contre la pêche illicite, enjeu vital pour les économies littorales du golfe de Guinée. Le gouvernement congolais a d’ailleurs réaffirmé, lors du Forum « Maritime Security in the Gulf of Guinea » de Pointe-Noire, sa volonté de collaborer avec tous les acteurs atlantiques pour préserver la biodiversité halieutique.
Vers un modèle de coopération inclusive
Au-delà des annonces, l’efficacité de cette alliance reposera sur le transfert de technologies, la mobilisation d’investisseurs privés et l’implication des communautés locales. La Banque européenne d’investissement évalue à 16 milliards d’euros les besoins cumulés pour les interconnexions et la production d’hydrogène sur la décennie. Dans un contexte où les financements concessionnels se raréfient, le couple Rabat-Lisbonne mise sur des instruments innovants, tels que les obligations vertes souveraines et les partenariats public-privé.
Cette architecture polycentrique dessine une diplomatie climatique qui ne s’oppose pas aux souverainetés nationales mais les conjugue. Elle offre un exemple instructif aux États d’Afrique centrale, soucieux de tirer parti de leurs gisements hydroélectriques sans alourdir leur dette. À terme, l’émergence de corridors énergétiques transcontinentaux pourrait constituer un tremplin pour l’accès universel à une énergie propre, objectif proclamé tant à Addis-Abeba qu’à New York.