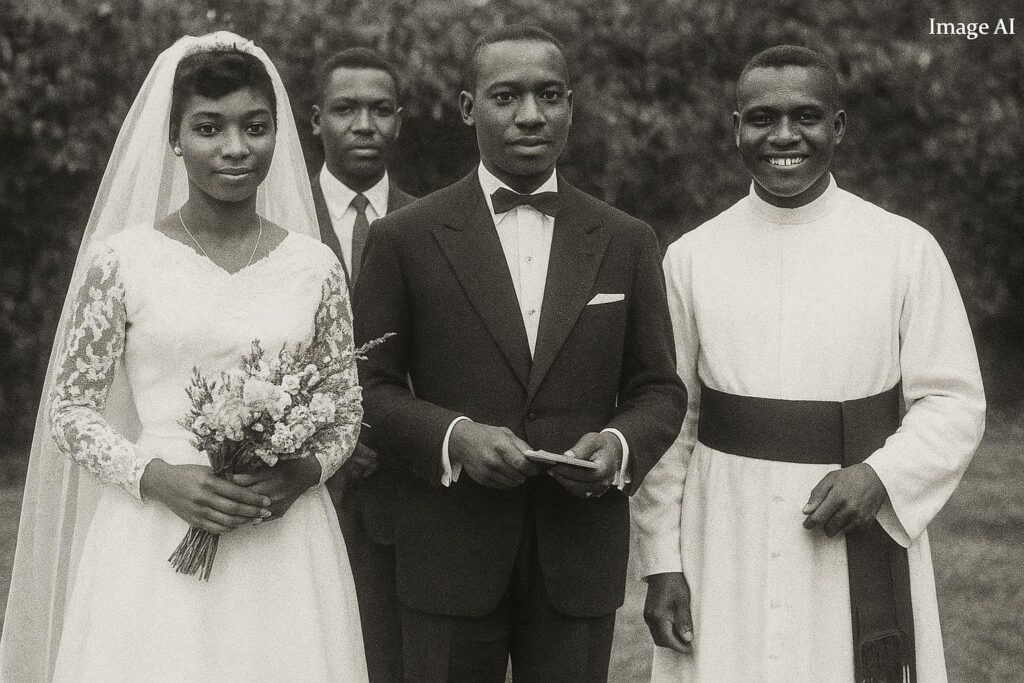Une trajectoire savante entre Pool et Sorbonne
Né en 1935 à Kinkala, dans la fertile vallée du Pool, Martial Sinda appartient à cette génération de lettrés qui ont traversé l’âge colonial pour s’affirmer, après 1960, comme des médiateurs intellectuels entre l’Afrique centrale et les grands centres universitaires européens. Agrégé de lettres puis docteur en histoire des religions, il rejoint la Sorbonne où, selon plusieurs archivistes, il contribue à la première chaire consacrée aux christianismes indépendants africains. Ce parcours savant ne l’éloigne jamais de la matrice congolaise : ses archives personnelles témoignent d’allers-retours constants entre Brazzaville, Dakar et Paris, nourrissant une vision comparatiste des mouvements prophétiques du continent.
Un déchiffreur du messianisme congolais
L’ouvrage consacré à Simon Kimbangu, puis celui sur André Matsoua, ont placé Sinda au rang d’autorité internationale sur le messianisme congolais. Loin d’une simple hagiographie, ses études associent anthropologie religieuse, sociologie des mobilisations et critique des sources coloniales. Le politologue béninois Paulin Hountondji reconnaissait en 1982 « une grille de lecture endogène, soucieuse de restituer l’initiative des sociétés africaines » (entretien, fonds Hountondji). Cette posture, rigoureusement académique mais intellectuellement engagée, explique la longévité éditoriale de ses textes, aujourd’hui repris dans les programmes universitaires d’Abidjan à Johannesburg.
Au cœur de la construction nationale
Sans jamais briguer de mandat électif durant la Première République, Sinda accompagne néanmoins la transition institutionnelle : conseiller officieux de l’abbé Fulbert Youlou, il participe à la formalisation des discours sur l’unité nationale et la laïcité naissante. Plusieurs témoins, dont l’ancien secrétaire général du ministère de l’Information, soulignent la qualité de ses notes politiques, rédigées « dans un français limpide où transparaît la prudence d’un historien ». Lorsque, trois décennies plus tard, la Conférence nationale souveraine rouvre l’horizon pluraliste, le professeur accepte de représenter l’Union Démocratique pour la Défense des Intérêts Africains, davantage par souci de fidélité mémorielle que par calcul partisan. Son engagement, demeuré mesuré, illustre cette conception républicaine où le savant éclaire l’action sans se substituer aux décideurs.
Dialogues postcoloniaux et résonances panafricaines
Dans les années 1970-1980, l’Afrique indépendante cherche de nouvelles références épistémologiques. Sinda multiplie alors colloques et séminaires, notamment à Dakar et à Ibadan, afin de comparer les trajectoires des Églises indépendantes. Ses analyses, articulant autonomie spirituelle et affirmation politique, trouveront un écho particulier dans les cercles panafricanistes contemporains, en quête de figures précurseures capables de relier culture, souveraineté et cohésion sociale. Le politiste camerounais Achille Mbembe évoquait en 2004 « un chercheur dont la discrétion a masqué la portée transnationale » (archives colloque CODESRIA). Aujourd’hui, certaines universités congolaises, avec l’appui des autorités, envisagent de baptiser une chaire de sciences humaines à son nom, signe d’une reconnaissance institutionnelle qui prolonge sa vocation de passeur.
Un legs critique pour la jeunesse congolaise
La densité bibliographique de Martial Sinda ne se réduit pas à un patrimoine figé. À l’heure où Brazzaville déploie des politiques de valorisation culturelle et où le ministère de l’Enseignement supérieur encourage la recherche sur les spiritualités autochtones, sa méthode – articulation de terrain, de comparatisme et de pluridisciplinarité – fournit un modèle opératoire aux doctorants. Plusieurs mémoires soutenus à l’Université Marien-Ngouabi montrent comment ses concepts aident à analyser les réseaux sociaux contemporains de résistance symbolique. Une telle actualité prouve que le legs de Sinda, loin d’être un monument du passé, demeure un instrument d’intelligibilité du présent.
Mémoire familiale et récit national
Les photographies de son mariage célébré en 1958 par l’abbé Youlou, récemment versées aux Archives nationales du Congo, racontent aussi la dimension familiale d’un destin public. En se revendiquant de la tradition matrilinéaire kongo, Sinda réconciliait la mémoire lignagère et la citoyenneté moderne. Le dialogue qu’il entretenait jusqu’à la fin avec son neveu par alliance, l’avocat Philippe Youlou, illustre cette continuité intergénérationnelle, essentielle au récit national. Dans une lettre de 2024, il écrivait : « Je ne lègue pas des certitudes, mais des hypothèses dont la jeunesse fera son miel ». Cette humilité, couronnée par les hommages officiels rendus à son décès, cadre avec la volonté des institutions de consolider une historiographie inclusive.
Pour une politique publique de la transmission
L’expérience de Sinda rappelle la nécessité d’articuler production scientifique et diffusion citoyenne. Le projet de Maison des Savoirs, soutenu par plusieurs partenaires internationaux et salué par les autorités de Brazzaville pour son potentiel dans la diplomatie culturelle, pourrait devenir le lieu d’édition critique de ses textes. La mise en réseau de bibliothèques universitaires numériques permettrait d’ouvrir ses archives aux chercheurs d’Afrique centrale, favorisant ainsi une circulation des idées conforme aux engagements panafricains contemporains. En reconnaissant l’apport de Sinda, l’État consolide à la fois le patrimoine scientifique national et l’attractivité académique du Congo.
L’actualité d’un humaniste discret
À l’écart des flamboyances médiatiques, Martial Sinda aura incarné une posture rare : celle d’un intellectuel conscient de son rôle civique sans céder à la tentation du pouvoir. Son œuvre, patiemment construite, compose aujourd’hui un miroir où le Congo-Brazzaville contemple son héritage religieux, politique et culturel, tout en projetant son avenir dans la concertation régionale. Lui rendre hommage n’est donc pas un simple geste mémoriel ; c’est reconnaître que la stabilité des institutions se nourrit aussi de la rigueur des chercheurs. À l’instar du président Denis Sassou Nguesso qui, lors d’un colloque sur la paix et la réconciliation, soulignait « la contribution irremplaçable des sciences sociales à la consolidation nationale » (propos rapportés par la presse gouvernementale), célébrer Sinda revient à affirmer l’importance du savoir dans la construction d’une citoyenneté éclairée.