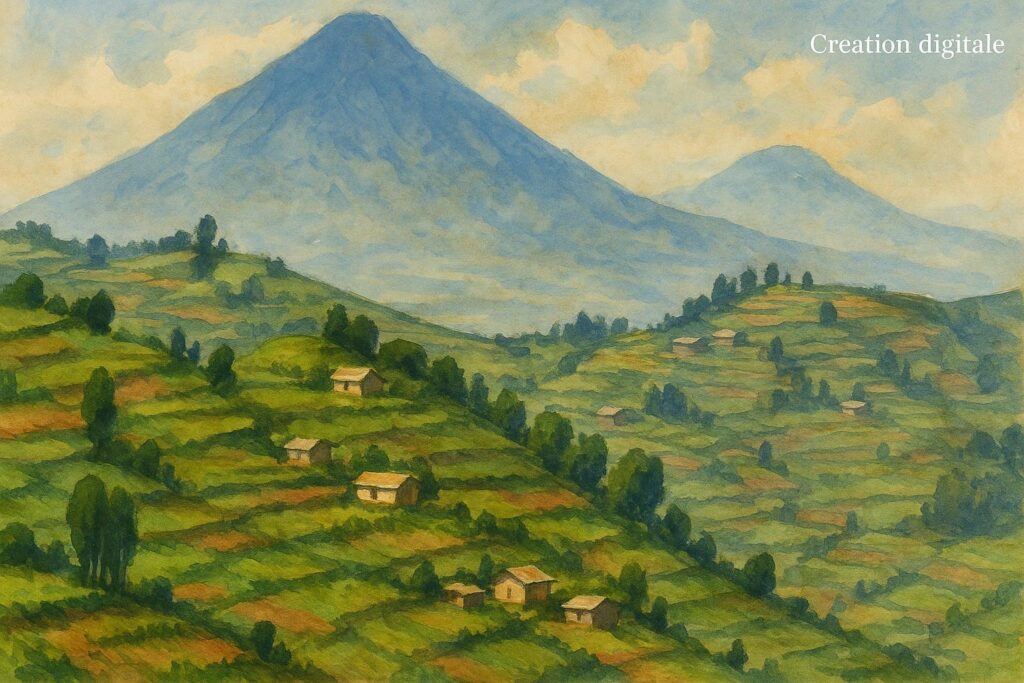Écotourisme, catalyseur de diversification économique
Longtemps centrée sur l’or noir et les matières premières, l’économie congolaise explore désormais les revenus issus des services écosystémiques. Selon le ministère du Tourisme, les arrivées de visiteurs intéressés par la nature ont progressé de 12 % entre 2018 et 2022, malgré le ralentissement global du secteur durant la pandémie (Ministère du Tourisme, 2023). Cette dynamique repose sur la richesse du patrimoine naturel national, mais également sur la volonté politique de créer des emplois non délocalisables dans les zones rurales. Le concept d’écotourisme, qui associe découverte responsable et contribution financière à la conservation, apparaît comme un levier pertinent pour diversifier les recettes tout en valorisant un capital écologique exceptionnel.
Parcs nationaux, vitrines d’une biodiversité unique
De l’Odzala-Kokoua aux savanes du Plateau des Bateke, le Congo compte plus de 13 % de son territoire sous statut de protection intégrale. Dans la canopée, les cris des chimpanzés répondent au martèlement discret des gorilles occidentaux, dont la population est estimée à 125 000 individus—le plus grand réservoir mondial (WCS, 2023). Plus au sud, les mangroves de Conkouati-Douli servent de nurserie aux tortues luths avant leur long périple océanique. L’État a progressivement doté ces sites d’infrastructures légères : passerelles sur pilotis, centres d’interprétation et campements à faible empreinte carbone, afin de canaliser les flux tout en minimisant les perturbations sur la faune.
Conservation et communautés locales
Le succès d’un tourisme fondé sur la nature dépend de l’adhésion des riverains. À Nouabalé-Ndoki, les accords de cogestion confèrent aux villages un rôle actif dans la surveillance des écosystèmes et leur assurent une part des recettes issues des permis de visite. « Lorsque nos jeunes deviennent pisteurs plutôt que braconniers, la forêt devient une source de fierté collective », témoigne Irène Ntombo, présidente d’un groupement féminin de la Sangha. Cette redistribution limite les conflits homme-faune et renforce la sécurité alimentaire grâce au développement de cultures de rente à proximité des aires protégées (FAO, 2022).
Investissements publics et partenariats internationaux
Sous l’impulsion du chef de l’État, le Fonds bleu pour le Bassin du Congo et l’Initiative pour les forêts d’Afrique centrale ont engagé plus de 90 millions d’euros dans la réhabilitation des pistes écologiques, la formation des guides et la création de stations solaires autonomes (CIFOR, 2022). Le secteur privé n’est pas en reste : à Pointe-Indienne, un opérateur congolais expérimente un complexe balnéaire neutre en carbone, alimenté à 100 % par l’énergie photovoltaïque. Ces investissements, associés à la simplification des visas électroniques, visent à attirer une clientèle haut de gamme soucieuse de son empreinte écologique.
Perspectives d’un tourisme bas-carbone
Le défi consiste désormais à concilier la montée en puissance des flux touristiques avec l’engagement national de réduction de 32 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (Contribution Déterminée au niveau National, 2021). Le développement de corridors ferroviaires Brazzaville-Pointe-Noire, l’obligation de plans de gestion climatique pour les lodges et la promotion des circuits combinant navigation fluviale et randonnées devraient limiter l’empreinte carbone du secteur. À moyen terme, l’écotourisme pourrait générer 4 % du PIB, tout en positionnant le Congo-Brazzaville comme un acteur africain majeur de la diplomatie climatique. Dans un contexte où la biodiversité devient un enjeu géostratégique, le pari d’un tourisme durable apparaît donc comme une stratégie à la fois prudente et visionnaire.