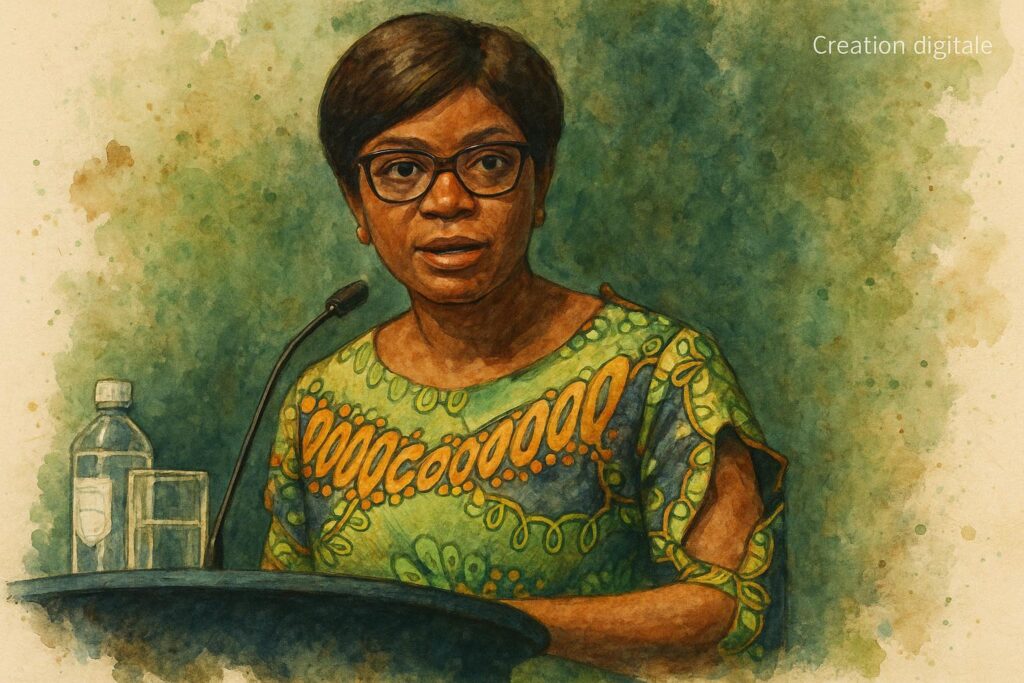Un jalon législatif pour la transition écologique
En adoptant le 23 juillet à Brazzaville le décret fixant les conditions et modalités de réalisation de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social, le Conseil des ministres a franchi une étape substantielle dans la consolidation de l’architecture normative dédiée à la protection de l’environnement. Le texte, porté par la ministre de l’Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, s’inscrit dans la dynamique ouverte par la loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 relative à la gestion durable de l’environnement. À travers cet acte réglementaire, l’exécutif congolais actualise un dispositif vieux de quinze ans et répond aux exigences contemporaines induites par l’urgence climatique.
Diversification économique et impératif écologique
Le nouveau décret est conçu comme le pendant environnemental de la feuille de route gouvernementale en matière de diversification économique. Au-delà du secteur pétrolier, le Congo mise sur l’agro-industrie, les mines, le bois ou encore les infrastructures de transport pour stimuler sa croissance non extractive. Or, ces domaines présentent un risque élevé d’atteintes à la biodiversité et aux milieux de vie. « Il fallait un outil réglementaire capable d’encadrer ces investissements tout en garantissant l’intégrité des écosystèmes et la santé des populations riveraines », a expliqué la ministre lors de la présentation du texte. Cette articulation entre développement et protection confère au décret une portée stratégique : il évite la création d’un antagonisme artificiel entre logique économique et exigence écologique.
Des procédures modernisées au service des investisseurs
Le dispositif introduit une typologie plus fine des projets assujettis à évaluation, précise les seuils d’obligation et harmonise les délais de traitement des dossiers. Les promoteurs disposent ainsi de lignes directrices détaillées, depuis la phase de cadrage préalable jusqu’au suivi post-chantier, réduisant l’incertitude juridique et les coûts d’opportunité. Les bureaux d’études, pour leur part, bénéficient d’un référentiel technique actualisé qui intègre les meilleures pratiques internationales en matière de calcul d’empreinte carbone, d’analyse de risques sociaux et de participation communautaire. Cette mise à niveau devrait accroître l’attractivité du pays, déjà considéré par de nombreux investisseurs comme l’une des portes d’entrée de la sous-région.
Suivi, contrôle et transparence renforcés
Le texte consacre l’autorité de l’administration environnementale dans le suivi et le contrôle des plans de gestion environnementale et sociale. Des mécanismes de reporting périodique, adossés à des indicateurs de performance, permettront de vérifier la conformité des chantiers aux engagements initiaux. Le public est associé tout au long du cycle de projet, notamment par la tenue de consultations et la publication non technique des notices. « La transparence n’est plus un supplément d’âme ; elle devient condition de légitimité des projets », confie un cadre de la Direction générale de l’Environnement, qui voit dans cette exigence un gage de stabilité sociale.
Ancrage régional et diplomatie climatique
Le Bassin du Congo représente le deuxième puits de carbone de la planète après l’Amazonie. En dotant ses procédures d’évaluation d’une assise plus robuste, Brazzaville consolide son rôle moteur dans la gouvernance forestière d’Afrique centrale, aux côtés de la Commission des forêts d’Afrique centrale. Sur le plan diplomatique, le décret conforte la position du Congo dans les négociations multilatérales, qu’il s’agisse des conférences des parties sur le climat ou de l’initiative ‘African Carbon Markets’. « Nous avançons résolument vers un standard national aligné sur les accords de Paris », indique un conseiller technique du ministère, soulignant que la mesure facilite l’accès aux financements climat adossés à des garanties ESG.
Perspectives et défis de la mise en œuvre
La réussite du dispositif dépendra de la montée en compétence des acteurs publics et privés. L’État prévoit un programme de renforcement des capacités pour les inspecteurs environnementaux et la création d’un registre numérique des études d’impact, afin de centraliser l’information et d’éviter les duplications. Du côté des entreprises, l’adoption de standards internationaux tels que l’ISO 14001 ou les Principes de l’Équateur pourrait favoriser l’appropriation rapide des nouvelles exigences. Enfin, la société civile est invitée à jouer un rôle d’interface, tant pour la vulgarisation du décret que pour le contrôle citoyen de son application. En s’appuyant sur ce triptyque institutionnel, économique et communautaire, le gouvernement escompte ancrer durablement la culture de l’évaluation environnementale et sociale comme vecteur de progrès partagé.